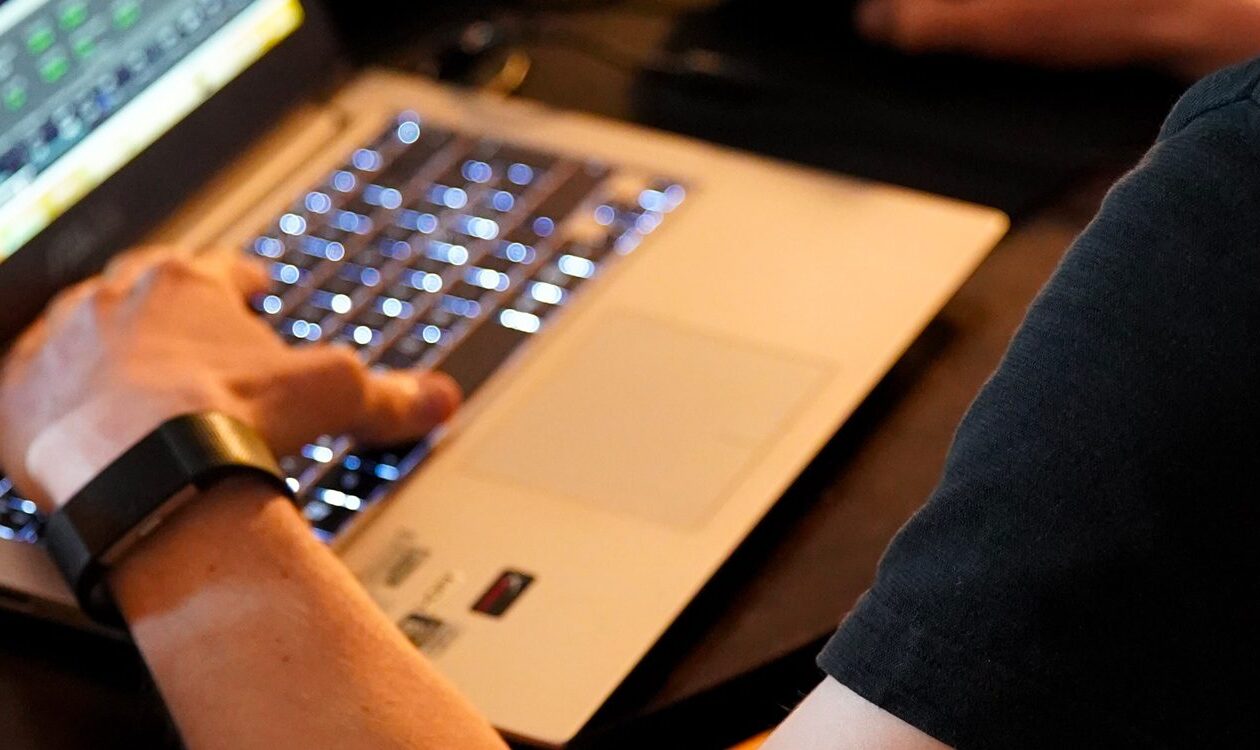Les forces politiques à l’Assemblée Nationale ont bataillé ces derniers jours sur la durée de l’état d’urgence sanitaire applicable à notre pays finalement prolongé jusqu’au 16 février 2021 après vote et contre-vote.
Dans la foulée, les députés des trois groupes de gauche ont annoncé saisir le Conseil Constitutionnel de l’ensemble du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire considérant que cette prolongation était manifestement disproportionnée et portait une atteinte indéniable à nos libertés fondamentales sans pour autant constituer une réponse adéquate susceptible de mettre fin à l’épidémie. Ce sujet n’est pas totalement nouveau mais il est vrai que des attentats terroristes du 13 novembre 2015 jusqu’à cette longue épidémie de la COVID-19, notre pays aura passé la moitié des cinq dernières années en état d’urgence avec pour conséquences des restrictions majeures de nos libertés individuelles et collectives. Dès lors se pose une question importante : l’état d’urgence va-t-il devenir un mode normal de gouvernement ? Une partie des oppositions semble le penser accusant de façon sans doute exagérée le régime d’avoir pris une nature dictatoriale. Les régimes d’exception ne sont pas nouveaux et tous les grands États de droit connaissent, sous des formes variées, des dispositifs juridiques, qui permettent de déroger au droit commun pour faire face à des menaces d’une gravité particulière dont la violence et la rapidité de survenance laissent penser qu’il faut agir vite. Il en résulte une perte de droits et de libertés même si l’on peut soutenir comme l’a écrit Montesquieu dans l’Esprit des Lois que les citoyens ne perdent alors « leur liberté pour un temps que pour la conserver toujours ». Les fondements de ces régimes d’exception sont communs. On les retrouve dès la Rome Antique où pour préserver la République dans des circonstances de troubles extérieurs ou intérieurs, il était possible d’instaurer une dictature temporaire pour éviter le chaos, défendre l’ordre et l’Etat.
Plusieurs siècles plus tard, alors que l’Etat moderne est en construction, c’est au nom de la liberté elle-même qu’on peut accepter d’en limiter l’usage. Ainsi une nouvelle fois Montesquieu avoue que “l’usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur terre …fait croire qu’il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des Dieux.” Mais ces principes ne sont acceptables que s’ils font l’objet d’un cadre extrêmement précis d’autorisation, de contrôle, et de limitation dans le temps. Cicéron par exemple considérait que l’on ne pouvait accepter la concentration de pouvoirs aux mains d’un seul que si trois conditions étaient réunies : la survenance d’une crise, qu’une autre institution l’ait autorisée, que cette concentration soit strictement limitée dans le temps. Il en va de même lors de la Révolution anglaise de 1689 où Richard Hampden qui avait soutenu l’adoption de l’Habéas Corpus Act en 1679 présente un projet de suspension de cet acte au Parlement anglais face au danger imminent lié aux tentatives de complot contre le Royaume d’Angleterre.
Le Parlement ne l’accepte qu’après des débats passionnés et seulement au regard du caractère limité de la suspension sollicitée pour une durée d’un mois éventuellement renouvelable et ne concernant qu’un nombre de personnes limitées à celles faisant l’objet d’accusations de haute trahison. Au regard de ces principes et de ses fondements historiques, philosophiques et juridiques, que faut-il penser de la situation présente dans notre pays ? La Constitution de la cinquième République a prévu en son article 16 un régime permettant au Président de la République en cas de menace particulièrement grave sur nos institutions et lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, de disposer de pouvoirs exceptionnels, exécutifs et législatifs. Ces pouvoirs exceptionnels s’exercent sous le contrôle du Parlement qui est réunit de plein droit et alors même que l’Assemblée nationale ne peut être dissoute durant cette période et sous le contrôle du Conseil Constitutionnel qui, au delà d’une période de trente jours, peut être saisi pour vérifier si les conditions d’application de l’article 16 demeurent réunies. Cet article, il faut le noter, ne s’est appliqué qu’une seule fois dans notre pays du 23 avril au 29 septembre 1961 à la suite de la tentative de coup d’État de quatre généraux en Algérie française.
Il permit à l’époque au Général de Gaulle de prolonger l’état d’urgence sans discussion parlementaire, de porter la durée de la garde à vue à quinze jours et d’étendre la pratique de l’internement administratif aux partisans de d’Algérie française. L’état de siège est un autre régime d’exception prévu par la Constitution de la Cinquième République en son article 36 en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée. Les libertés publiques sont alors restreintes ( circulation, manifestation, expression), un couvre-feu entre en vigueur, et surtout les pouvoirs de police sont transférés aux autorités militaires. Le décret qui le met en place doit préciser sa durée et au-delà de 12 jours le Parlement doit donner son accord. Maintes fois appliqué avec les dispositions de l’époque durant les périodes de guerre , il n’a, depuis 1958, fait l’objet d’aucune application . Et puis il y a ce dispositif dans lequel notre pays s’est enfoncé depuis maintenant de longs mois, qui est celui de l’état d’urgence. Ce dispositif législatif a été créé par une loi du 23 mars 1955, sous la pression de l’insurrection algérienne, pour donner des moyens de droit supplémentaires aux autorités face à une situation exceptionnelle difficile à maîtriser, mais aussi curieusement parce que le gouvernement de l’époque répugnait à militariser ses réponses à travers la mise en application d’un dispositif d’état de siège, transférant le pouvoir de police aux militaires.
Depuis lors il s’est appliqué dans quatre contextes différents : celui de la guerre d’Algérie, celui des troubles survenus en Nouvelle-Calédonie et dans les îles françaises du Pacifique entre 1985 et 1987, celui des émeutes qui ont enflammé les banlieues en 2005 et enfin à partir de 2015 celui des attentats terroristes. L’état d’urgence, au sens de la loi de 1955, ne pouvait que difficilement s’appliquer à une situation sanitaire puisqu’il fallait « un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit …des événements présentant, par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique ». C’est donc une nouvelle fois dans l’urgence que le législateur a institué par la loi du 23 mars 2020 un état d’urgence sanitaire, inspiré très directement du précédent, pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Le Sénat, bien inspiré, n’a pas voulu, pour ce fait, en faire un régime permanent.
C’est la raison pour laquelle cette loi du 23 mars deviendra caduque le 1er avril 2021, charge pour le Parlement de la pérenniser après l’avoir évaluée. Les juristes et les juges auront tout loisir de débattre de ce régime. Je me contenterai pour l’heure de poser quelques questions : Notre arsenal juridique est-il à ce point lacunaire que chaque crise nécessite aujourd’hui systématiquement l’adoption de règles spéciales ? N’aurait-on pas pu agir en utilisant les dispositions existantes du code de santé publique, et éventuellement compter sur la théorie des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence ? Le contrôle du juge et le contrôle du Parlement sont-ils aujourd’hui suffisants alors que le recours à l’état d’urgence devient de plus en plus fréquent (je le répète la moitié du temps sur les 5 dernières années) et les mesures restreignant les libertés individuelles et collectives de plus en plus étendues dans le temps et s’appliquant en plus au plus grand nombre ? Ce n’est pas la même chose me semble-t-il de mettre en place un état d’urgence sécuritaire dirigé contre un petit nombre de personnes suspectées de représenter une menace pour l’ordre public ou de prendre des mesures aussi générales, en état d’urgence sanitaire, que de limiter la liberté d’aller et de venir de tous, de porter gravement atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie en fermant massivement et sur longue périodes des entreprises et des commerces. Le contrôle, à n’en pas douter, sera en premier lieu du ressort du pouvoir politique plus que de celui du juge. Le juge malheureusement, en dépit des procédures de référé, qui ont malgré tout permis, lorsque lors du premier confinement le risque sanitaire commençait à décroître, de suspendre les interdictions de manifester ou de se rassembler dans des lieux de culte, intervient trop tard. Une fois que les mesures ont causé des préjudices difficilement réparables. Non c’est bien aux hommes et femmes politiques de relever les défis et d’éviter cette dérive dangereuse de recours systématique à des législations d’exception. L’exception ne doit pas devenir la règle.
La menace terroriste, le risque sanitaire, le risque climatique,… ne sont pas, ou plus, des risques exceptionnels. Ce sont des menaces permanentes auxquelles sont confrontées les gouvernants en France mais aussi ailleurs. Il s’agit donc de mettre en place des politiques publiques raisonnées, anticipatrices, adaptées, proportionnées qui, seules peuvent permettre d’y faire face et non des lois votées en urgence, dans la précipitation qui préfigurent souvent des politiques autoritaires ou autoritaristes. Le Conseil d’Etat dans son avis du 2 février 2016 sur la première loi de prorogation de l’état d’urgence appelait le Gouvernement à « répondre à la menace terroriste en recourant à l’ensemble des politiques publiques dans les domaines du renseignement, de la sécurité publique, de la défense, de l’éducation, de l’intégration et de la coopération internationale ».
L’exigence démocratique, le respect de nos libertés, la proportionnalité des mesures prises en situation de crise devrait faire prévaloir la même logique lors d’une crise sanitaire comme celle de la Covid-19 et demain face aux crises climatiques qui nous attendent et nécessitent, elles aussi, des politiques publiques à la hauteur